Le
radioguidage RDS : 2ème partie
Dossier technique réalisé
par David Gestalder
|
Configuration
du signal RDS
Le signal RDS est constitué
d'une trame numérique (cf. fig. 1). Cette trame est une suite synchrone
de groupes de 104 bits (un groupe a une durée de 87,6 ms. Le débit
de la trame est 11,4 groupes par seconde). Un groupe contient quatre blocs
de données de 26 bits chacun (soit 4 x 21,9 ms) dont 16 bits de
données et 10 bits de contrôle/décalage.
Les 10 bits de contrôle/décalage
synchronisent les données et constituent un code de détection
d'erreurs capable d'assurer la correction des types d'erreurs suivants
:
- jusqu'à cinq erreurs
consécutives.
- salve d'erreur de 10 bits
consécutifs.
- erreurs simples et doubles
dans un bloc.
- détection de 99,8
% des salves d'erreurs de 11 bits.
- détection de 99,9
% des salves d'erreurs de plus de 11 bits. |
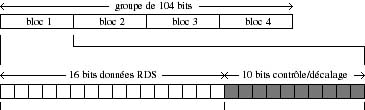
Fig. 1 : la trame numérique
RDS
|
| Chaque groupe de la trame
numérique RDS est identifié par un code sur 4 bits inséré
au début du bloc 2, on dispose donc de 4 x 4 = 16 types de groupes.
Chaque type existe en deux versions dites A et B. Le bit MSB (poids fort)
de tous les codes RDS est transmis en premier (le bit MSB est affecté
de la puissance de 2 la plus élevée). La figure 2 est un
exemple d'identification des bits MSB (poids fort) et LSB (poids faible). |
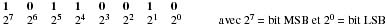
Fig. 2 : les poids binaires.
|
Chaque fonction RDS est conforme
à une procédure de codage binaire établie par l'UER
et le CENELEC (Revue Technique
3244-F de l'UER et norme prEN50067 du CENELEC devenue depuis la norme NF EN
50067), voici les applications actuellement en vigueur.
Codage
des services RDS
Code de type de
groupe :
Figure 3 : dans la colonne
B0 du code binaire, la lettre X représente la valeur binaire 0 pour
les groupes en version A et la valeur binaire 1 pour les groupes en version
B.
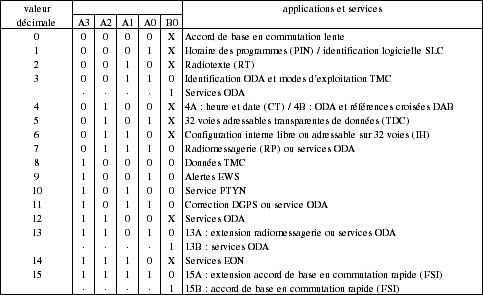
Fig. 3 : codes des types de groupes.
Codes TP (Traffic
Program) et TA (Traffic Annoucement) :
Figure 4 : ces deux codes
pour les informations routières sont des drapeaux numériques
qui indiquent un état de commutation.
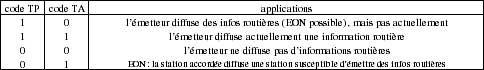
Fig. 4 : les drapeaux TP et TA.
Code DI (Decoder
Identification) :
Figure 5 : les quatre bits
du code DI sont diffusés l'un après l'autre sur quatre groupes
0A/B ou sur quatre groupes 15B. Sur le groupe 0, chaque bit du code DI
est identifié par le code d'adresse des caractères du nom
de la station (fonction PS). Sur les groupes 15B, les bits DI sont identifiés
par un code d'adresse sur 2 bits (cf. fig. 6).
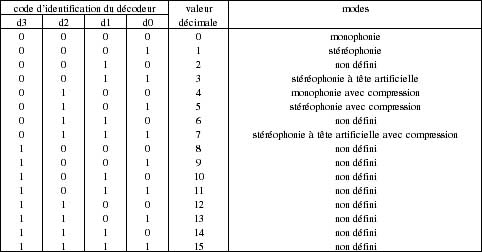
Fig. 5 : configuration du code DI.
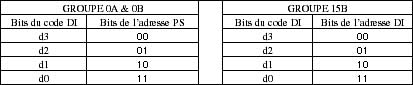
Fig. 6 : adressage du code DI.
Codes AF (Alternative
Frequency) :
Fig. 7a à
7h : codage des fréquences.
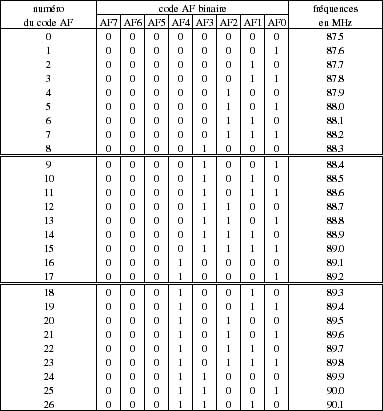
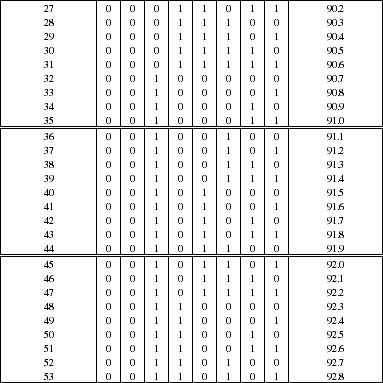
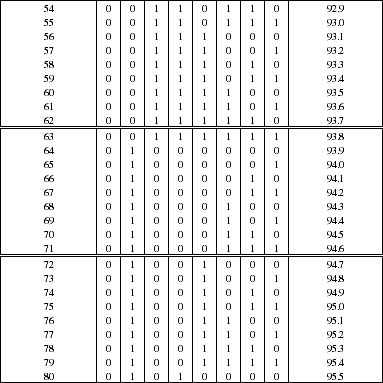
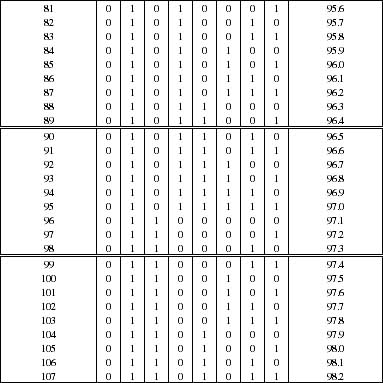
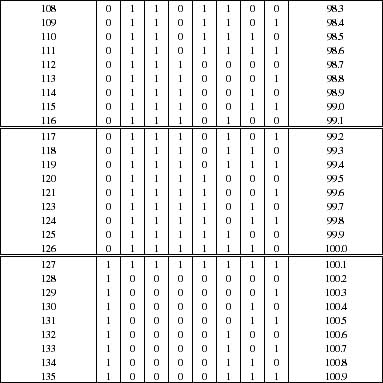
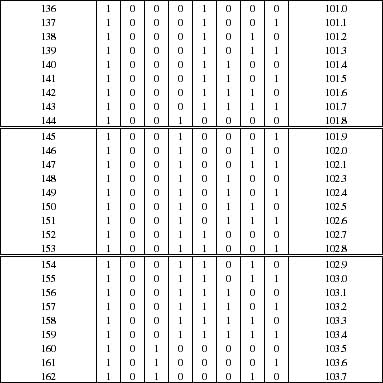
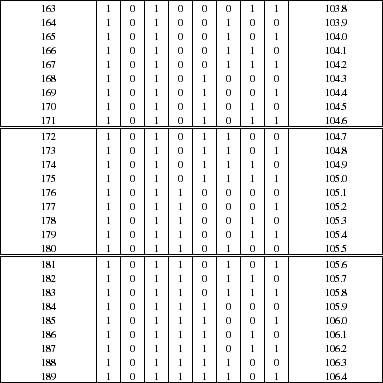
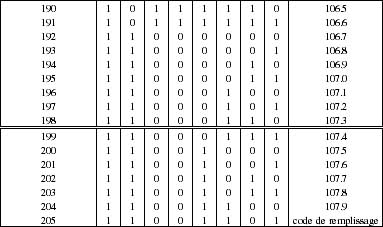
| Sur la dernière partie
de la figure 7, le code 205 (11001101 en binaire) appelé code
de remplissage permet de combler les éléments AF des blocs
RDS qui demeurent libres. Il est utilisé comme octet de bourrage
afin de compléter la trame numérique diffusée. Lorsque
l'émetteur d'une station est unique (fonction AF non exploitée),
le codeur RDS doit diffuser le groupe 0B. En effet, le bloc 3 du groupe
0A ne peut pas être mis à zéro (salve de 16 bits à
zéro > 00000000 00000000) puisque ce code correspond à la
fréquence 87,5 MHz. Lorsqu'une telle station souhaite implémenter
le service AF, on utilise le bloc 3 du groupe 0A en protocole A. Voici un
exemple avec la station Autoroute
Info :
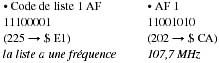
Les codes 206 à 223
(11001110 à 11011111) liés au service AF ou EON-AF ne sont
pas encore attribués par
l'UER.
Sur la figure 8, les codes 224 à 250 indiquent toutes les fréquences
disponibles de la liste AF. Le code 250 précède toujours
le code AF d'une fréquence en ondes longues (OL) et moyennes (OM)
quel que soit le protocole de codage de liste utilisé (A ou B).
Les codes 251 et 252 (11111011 et 11111100) ne sont pas attribués
par l'UER.
|
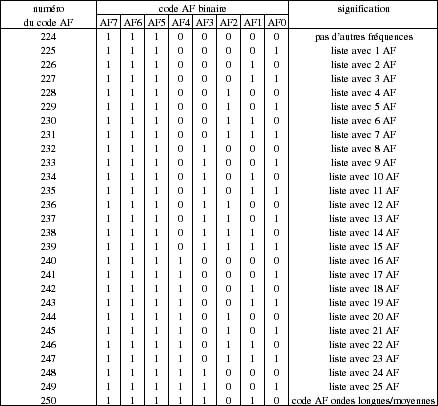
Fig. 8 : code des listes
AF.
|
Sur la figure 9, les trois
codes 253, 254 et 255 indiquent le décalage fréquentiel du
deuxième code AF du bloc.
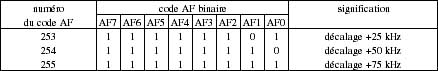
Fig. 9 : décalage
fréquentiel.
| Les listes AF peuvent être
diffusées selon deux protocoles : A ou B (cf. fig. 10). La méthode
A est utilisée en priorité tandis que la méthode B
est réservée pour les réseaux constitués de
nombreux réémetteurs (zones montagneuses) et les réseaux
proposant le service EON. Le protocole B nécessite un temps d'analyse
plus long, les auditeurs risquent alors de percevoir une coupure sonore
lors des commutations fréquentielles. Actuellement en France, seuls
quatre émetteurs de Radio
France exploitent le protocole B : le Pic du Midi (Toulouse), le Mont
Pilat (St Etienne), le Mont Rond (Gex) et le Mont du Chat (Chambéry). |
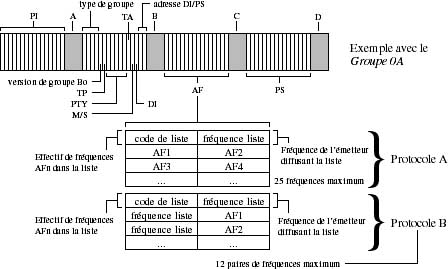
Fig. 10 : protocoles de
codage des listes AF.
|
Protocole A :
Chaque émetteur d'un
réseau diffuse une liste AF dont la première fréquence
est celle de l'émetteur qui produit la liste. Les autres fréquences
sont insérées dans la liste par paires successives avec un
maximum de 25 fréquences. Le premier code de la liste indique la
quantité de fréquences qui suivent.
Protocole B (ou carte de
fréquences) :
Chaque émetteur d'un
réseau diffuse une liste AF dont la première paire contient
le code de liste indiquant l'effectif de fréquences et la fréquence
de l'émetteur qui produit la liste. Les paires suivantes contiennent
la fréquence de l'émetteur qui produit la liste associée
avec une autre fréquence du réseau. Un maximum de 12 paires
est admis, au-delà la liste doit être fragmentée sur
plusieurs codeurs RDS du réseau (possibilité de coder plus
de 25 fréquences).
Une liste AF ne code jamais
deux fois la même fréquence. Si c'est le cas, la liste AF
est obligatoirement fragmentée. Les autoradios RDS peuvent identifier
le protocole AF utilisé (A ou B) par détection de la répétition
de la fréquence d'accord de la liste dans le protocole B. Précisons
que lorsqu'une paire de fréquences n'est pas utilisée intégralement,
elle est complétée par le code de remplissage AF 205 (11001101
en binaire).
Dans le groupe 14A du service
EON, le radiodiffuseur utilise le protocole B lorsqu'il souhaite lier avec
précision la fréquence de l'émetteur avec la fréquence
d'une autre station reçue dans la même zone.
Code PI (Program
Identification) :
Le code PI est la carte d'identité
numérique des stations de radio RDS. L'UER
(Union Européenne de Radiodiffusion) a défini les codes
PI avec les quatre valeurs hexadécimales suivantes codées
chacune sur 4 bits :
> premier chiffre (bits
0 à 3) : indicatif national du pays émetteur (cf. fig. 11).
> deuxième chiffre
(bits 4 à 7) : indicatif d'extension géographique du réseau
d'émetteurs.
|
1
|
stations
internationales (RFI en FM) |
|
2
|
stations
nationales (France Inter, France Info, ...) |
|
0
|
stations
locales |
|
4 à F
|
stations
régionales (valeur selon le CTR - Comité Technique Radiophonique) |
La figure 12 montre la liste
des stations régionales.
> troisième (bits
8 à 11) et quatrième chiffres (bits 12 à 15) : identification
du programme de la station de radio.
|
01 à 0A
|
service
public (valeurs décimales 0 à 10) |
|
0B à 1E
|
autres
réseaux nationaux (valeurs décimales 11 à 30) |
|
1F à 32
|
réseaux
régionaux sur un seul CTR (valeurs décimales 31 à
50) |
|
33 à 50
|
réseaux
régionaux sur plusieurs CTR (valeurs décimales 51 à
80) |
|
51 à 78
|
radios
locales (valeurs décimales 81 à 120) |
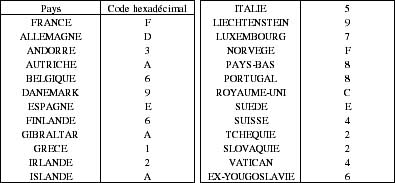
Fig. 11 : indicatifs
PI des principaux pays européens.
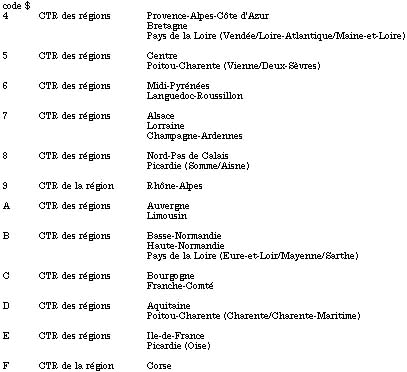
Fig. 12 : liste des
stations régionales
Dans la liste de la figure
12, le symbole $ indique qu'il s'agit d'une valeur hexadécimale.
Le contenu de la carte d'identité numérique PI des stations
de radio RDS est attribué par le CSA
(Conseil Supérieur de l'Audiovisuel).
Le code PI permet aux autoradios
RDS d'identifier à tout moment la fréquence d'une station
lorsque la fonction AF est activée. Dans le cadre de la fonction
EON-TA, le tuner retrouve la fréquence qui diffuse le code EON en
fin de commutation sur une information routière.
Code PTY (Program
TYpe) :
Ce code constitué
de 5 bits est diffusé sur le bloc 2 de tous les groupes RDS en version
A et B. Le service PTY permet à l'auditeur de connaître le
genre de programme qu'il écoute. Par analyse du code, l'autoradio
affiche le nom du programme sur un maximum de huit caractères. Les
cinq bits permettent de coder 31 types de programmes différents
(cf. fig. 13). Le code PTY 31 est réservé aux transmissions
d'urgence des secours publics (télécommande de sirène,
...). Il peut également alerter la population en cas d'événements
exceptionnels (tempêtes violentes, cyclone, tremblement de terre,
...). L'utilisation de ce type de programme est lié à la
diffusion des alertes sur le groupe 9A (code EWS).
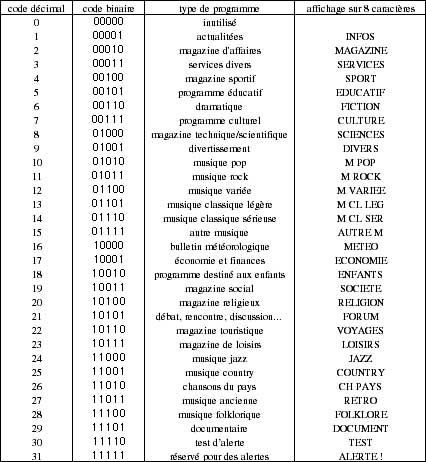
Fig. 13 : liste des
31 types de programmes.
Les
signaux de contrôle/décalage
| Les salves numériques
de contrôle/décalage insérées dans chaque bloc
de données permettent la détection des erreurs et la synchronisation
des blocs. La salve est un signal de décalage sur 10 bits associé
à un signal de contrôle également sur 10 bits. Actuellement
cinq signaux de décalage sont utilisés, ils sont représentés
sur la figure 14. |
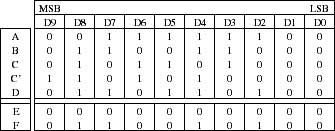
Fig. 14 : codes des signaux
de décalage.
|
En version A, les quatre
blocs de données numériques sont respectivement suivis des
signaux de décalage A, B, C et D. En version B, le signal C est
remplacé par le signal C'. Les signaux E et F sont réservés
pour des extensions futures du système RDS. Sur les 10 bits de décalage
seuls les bits D9 à D2 sont utilisés, les bits D1 et D0 sont
maintenus au niveau logique 0. La salve de contrôle/décalage
est implémentée par des calculs polynômiaux. Le code
cyclique de détection d'erreurs est conforme au polynôme générateur
g(x) :
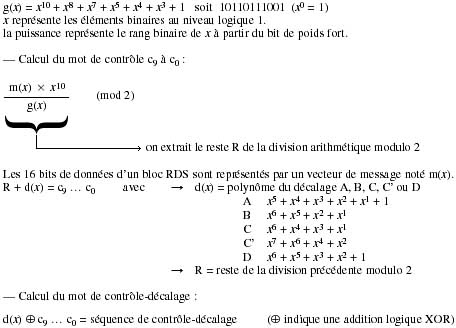
L'addition booléenne
XOR est équivalente à une addition arithmétique modulo
2. Le résultat numérique varie en fonction des données
contenues dans le vecteur message m(x), c'est-à-dire dans
le bloc RDS de 16 bits.
Conclusion
Dans cette deuxième partie
de notre dossier RDS, nous avons pu étudier les méthodes de codages
utilisées pour les divers services proposés par le système
RDS ainsi que le calcul de la détection d'erreurs insérée
dans les groupes numériques.